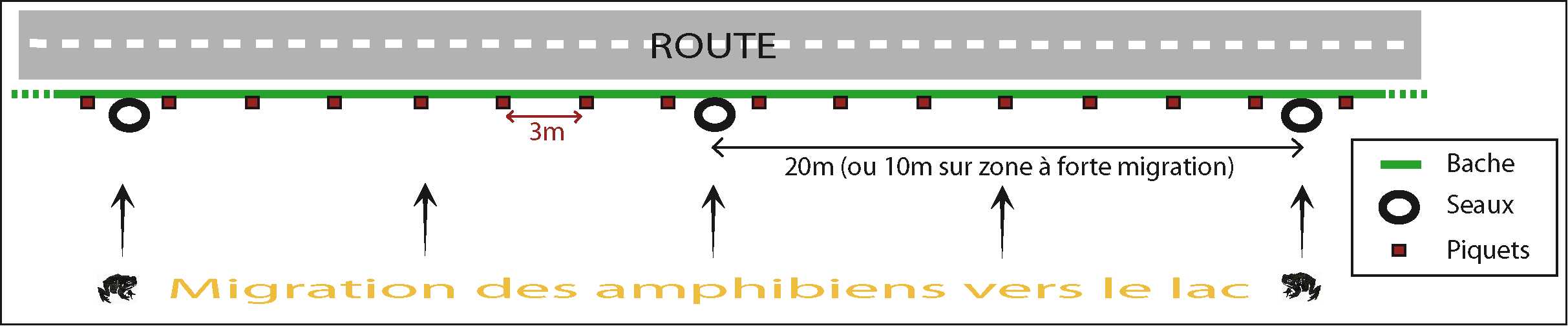La barrière piège est un
aménagement
provisoire qui permet de sauver certains
amphibiens
migrateurs en évitant leur écrasement sur les routes.
Ainsi, les crapauds communs hivernent dans des zones boisées et
rejoignent, aux alentours du mois de mars,
un
lac ou un étang pour se reproduire. Leurs effectifs peuvent
alors subir de très fortes pertes par écrasement lorsque le flux
migratoire les conduit à traverser des axes routiers.
Le but de la barrière piège est de bloquer les amphibiens avant la
traversée de ces axes, afin de les faire passer de l’autre côté sans
aucun risque. Ce procédé permet ainsi de sauver jusqu’à des milliers
d’animaux à chaque migration.
Le système est simple : il s’agit
d’installer une bâche d’environ 50 cm de hauteur sur une longueur
déterminée selon la zone de migration des amphibiens. Elle doit être
tendue et enterrée à sa base dans le sol.
Le long de cette bâche sont positionnés des seaux avec un espacement
d’une vingtaine de mètre (voire plus resserré pour les zones à fortes
migrations).
Quand les amphibiens arrivent au niveau de la
bâche, ils la longent, espérant
trouver un passage qui leur permettra de continuer leur chemin en
direction de leur lieu de reproduction habituel. Et c’est ainsi qu’ils
finissent par tomber au fond d’un seau… et se retrouvent prisonniers
jusqu’au petit matin !
La barrière piège est mise en place juste avant la période de migration
et retirée lorsque celle-ci se termine, les trous de capture étant alors
rebouchés.
Voir la fiche «
méthodologie
de
montage de la barrière piège ».
Pour la collecte des amphibiens, de nombreux bénévoles
passent
chaque matin afin de récupérer les animaux piégés dans les
seaux. Certains jours, c’est la déception, car en fonction des
conditions climatiques (par exemple des températures nocturnes négatives
ou des chutes de neige), les seaux sont vides, aucune migration n’ayant
eu lieu.
Lors de cette opération, les amphibiens doivent être parfaitement
identifiés, sexés, et bien sûr comptés. Toutes ces informations sont
compilées sur
une
fiche de notation journalière.
Les amphibiens sont ensuite emmenés directement sur leur site de
reproduction dans des caisses transparentes (viviers).
En parallèle, sur certains sites comme celui de La Cassière,
un
comptage des amphibiens écrasés sur les routes peut être effectué.
En effet, sur ce site, certains amphibiens hivernent en dessous du
chemin sur lequel est installée la barrière et ne sont donc pas
interceptés par celle-ci, d’où des écrasements inévitables.
Cette deuxième opération permet d’estimer au mieux la population
d’amphibiens présente sur le site mais aussi de juger au mieux la
pertinence de l’opération de sauvetage réalisée sur plusieurs
années.
Rapports scientifiques 2006 2007
2008